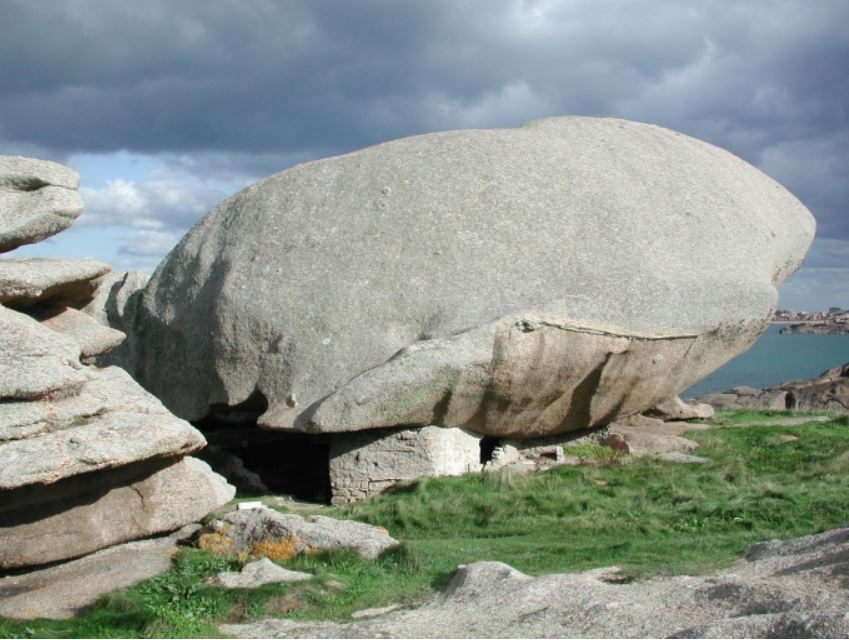Vêtement de travail et travail du vêtement en Bretagne
Le vestiaire breton est bien souvent ancré dans un imaginaire associé aux costumes ou aux coiffes, mais aussi aux tenues de marin, comme la vareuse, le ciré et bien sûr l’incontournable marinière. Au quotidien, jusqu’au milieu du 20e siècle, les Bretonnes et les Bretons portent aussi des habits spécifiques, adaptés à leur métier et à leur environnement. La création de ces vêtements est alors issu d’un travail domestique ou artisanal, puis changent de mode de fabrication. Leur vocation d’usage au travail se transforme par la même occasion. Illustration par des documents issus de fonds patrimoniaux présents sur le portail Bretania.
En Bretagne, la tenue vestimentaire du quotidien est distincte pour les hommes et les femmes. Les femmes portent des chemisiers et de longues jupes, revêtues de tabliers. Les hommes portent quant à eux des culottes, « bragoù », parfois larges ou bien ajustés.
Des tenues de travail pour les ouvrières
Les tenues de travail sont variées, on en trouve différents exemples pour des travaux s’exerçant en intérieur ou en extérieur.
Ici, les ouvrières agricoles de Brasparts (Monts d’Arrée) portent une combinaison, boutonnée et ceinturée, ainsi que des sabots de bois. Leur vêtement se doit d’être résistant aux intempéries et adapté à l’extraction de la tourbe, un travail physique et pénible.
Ouvrières en costume de travail. Source : Archives départementales d’Ille-et-Vilaine
Les ouvriers et ouvrières portent aussi des tenues de travail conçus par leur usine, faisant office d’uniforme. Les ouvrières de la poudrerie de Pont-de-Buis portent, de haut en bas, un béret, une combinaison et des souliers à talons.
Pont de Buis : Tenue des ouvrieres de la poudrerie Source : Dastum
Avec des travailleurs coloniaux, ces femmes viennent prêter main forte à cette usine d’armement finistérienne, durant la guerre 1914-1918 afin de remplacer les hommes partis au front.
Dans d’autres types d’industrie, comme les conserveries, les femmes n’ont pas de tenue spécifique et gardent donc leur coiffe durant le travail, comme ici à Pont L’Abbé.
Pont l’abbé, intérieur de l’usine de conserves J.Daniel & Cie. Source : Dastum
Des vêtements pour les gens de mer
Pour les hommes de mer, la tenue varie selon les corps de métier. Ceux de la Marine Nationale reçoivent dans leur trousseau une tenue d’uniforme, d’où provient la fameuse marinière et le couvre-chef à ponpon, aussi appelé bachi.
Portrait d’un marin. Photographie de 1920-1930 . Source : Musée départemental Breton
Les marins-pêcheurs et marins de commerce portent des toiles résistantes au sel et au vent. La vareuse est un vêtement réalisé en coton. Ils bénéficient tardivement de la création de textiles imperméables, grâce à la toile cirée, qui améliore leurs conditions de travail.
Pêcheurs à Concarneau par Tavik-Frantisek Simon, portant une vareuse et des sabots. Source : Musée départemental breton
Confectionner et entretenir le vêtement
Bigoudènes à la couture. Photographie. Source : Musée départemental Breton
Les confections sont la plupart du temps issues d’un savoir-faire domestique. Les travaux d’aiguilles occupent les longues soirées d’hiver et permettent de vêtir les membres d’une même famille. Mais la confection du vêtement n’est pas qu’une affaire de femmes : des artisans sont aussi à la tâche, comme les tailleurs, « kemener » en breton, qui confectionnent les vêtements sur mesure.
« Le père Diduiller », le vieux tailleur de Cast, début 20ème siècle. Source : Archives départementales d’Ille-et-Vilaine
Nombre de chansons et d’histoires sont liées à ce métier, on peut trouver par exemple ce témoignage en breton de Joseph Daniel receuilli par Yves Le Troadec sur le site de Dastum. Son travail nécéssitait un long apprentissage, il fallait s’astreindre à de nombreux déplacements et maîtriser les différents matériaux textiles.
De nombreuses pièces sont confectionnées en laine, mais également en chanvre, en toile de lin, parfois en coton. La dentelle et la broderie agrémentent les tenues, signes de richesse et d’appartenance. Le commerce et les échanges maritimes permettent d’apporter d’autres étoffes, comme la soie et les indiennes. Les motifs et les coupes évoluent au fil des modes.
Source : Archives départementales d’Ille-et-Vilaine
Les toilettes sont conservées longtemps et sont lavées par les lavandières, avec des techniques de lavage et de séchage.
Les lavandières se réunissent pour laver le linge, avant de le faire sécher Source : Dastum
Dans un autre registre, dans le centre-bretagne, les toiles et vêtements étaient souvent recyclés pour en faire du papier ou d’autres tissus. Ce commerce de la récupération est exercé par de petits paysans, notamment dans les Monts d’Arrée. Cultivant de très petits lopins d’une terre naturellement pauvre, ou tout simplement journaliers ou métayers, ils complètent leurs revenus en devenant chiffonniers ambulants en dehors des périodes de travaux des champs. Pour en savoir plus, lire l’article « Pilhaouaerien et Pillotous, chiffonniers de Bretagne » sur Bécédia.
Le tournant industriel
Des usines s’implantent progressivement en Bretagne permettant une production de produits textiles en masse. La Bretagne n’accueille pas beaucoup d’usines mais certaines marques émergent tout de même au XXème siècle : le ciré jaune chez Guy Cotten, les marinières chez Armor Lux, le kabig chez Le Minor en sont des exemples. A ce sujet, lire l’article : « Le kabig, ou la conversion urbaine d’un vêtement de travail » sur Bécédia.
Ici, une publicité de la marque Le Minor pour le kabig, un manteau fait de laine, très populaire dans les années 70. Source : Musée départemental Breton
L’industrialisation du domaine du textile et le commerce des produits vestimentaires fonctionne un temps mais les entreprises font face à des difficultées économiques.
Reportage dans les usines de production de vêtements en Bretagne, en l’année 2000 : « Le point sur l’industrie textile en Bretagne ». Source : INA, l’Ouest en Mémoire
Malgré la forte concurence et la réduction de la production textile, quelques marques subsistent et proposent encore du prêt-à-porter « local ». On retrouve avec une actualisation les pièces qui ont fait la réputation de la Bretagne, et jadis utilisés comme vêtements de travail. Beaucoup de ces habits sont toujours portés au quotidien comme la marinière, le kabig, le ciré jaune, la casquette, ou encore le pull en laine.
Écrit par Soizick Aubry